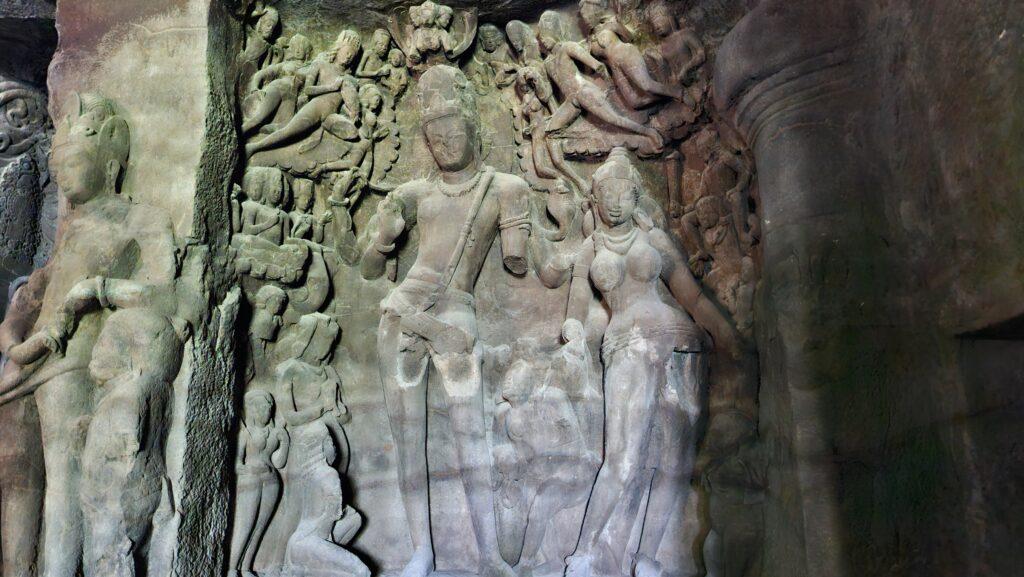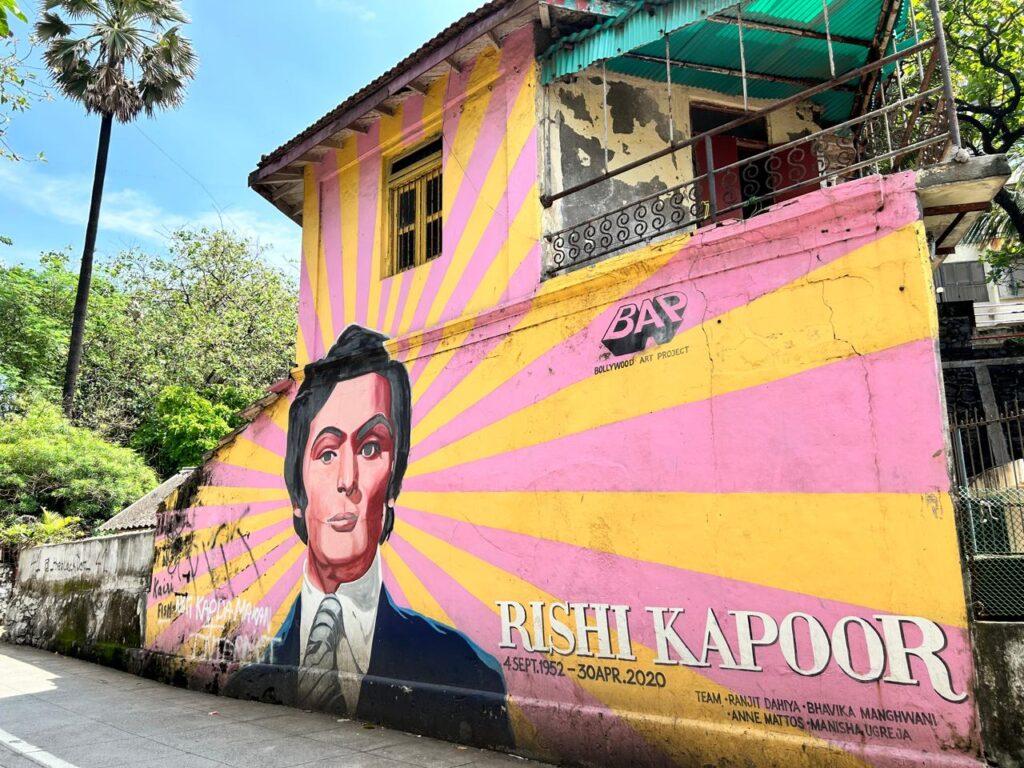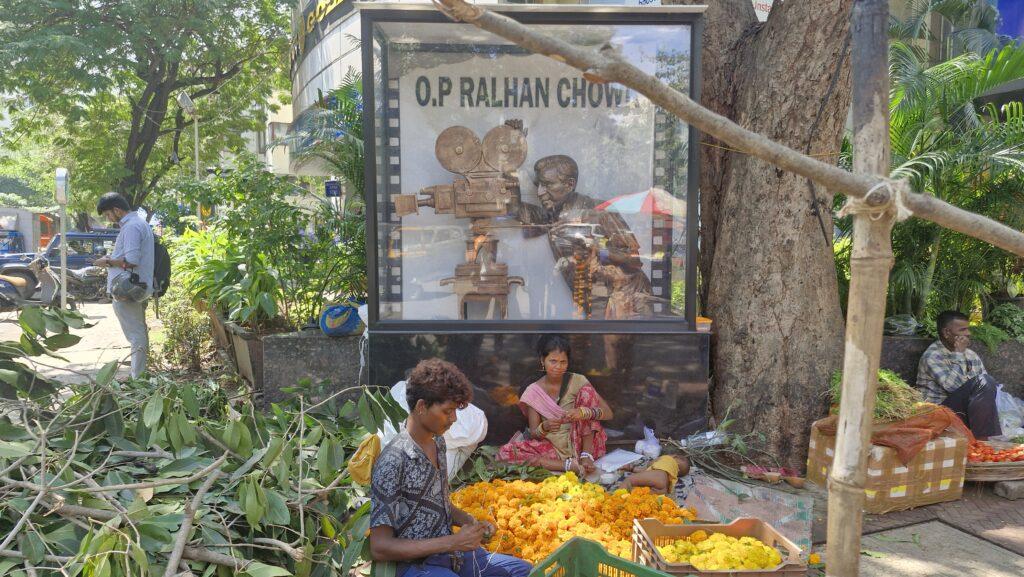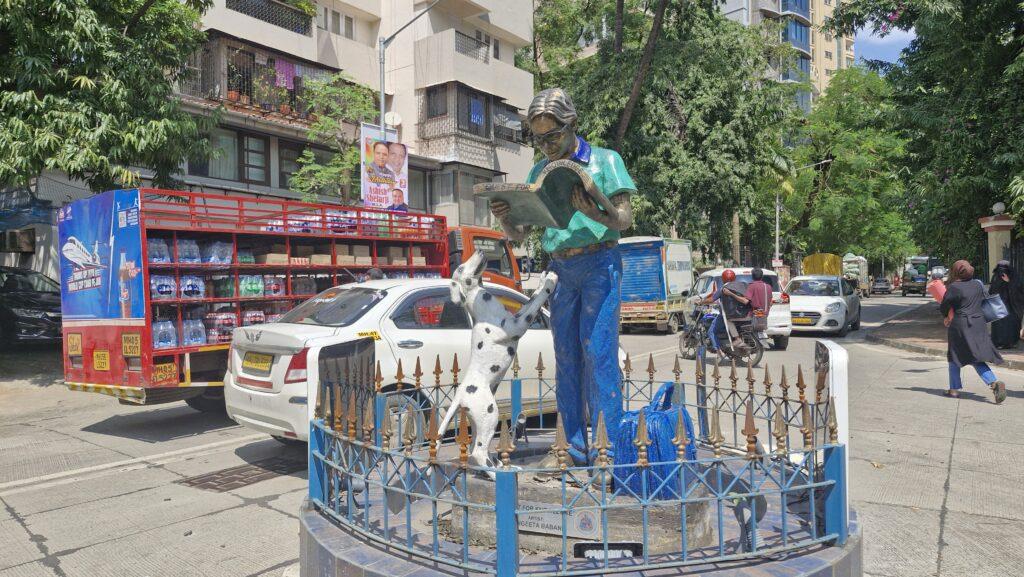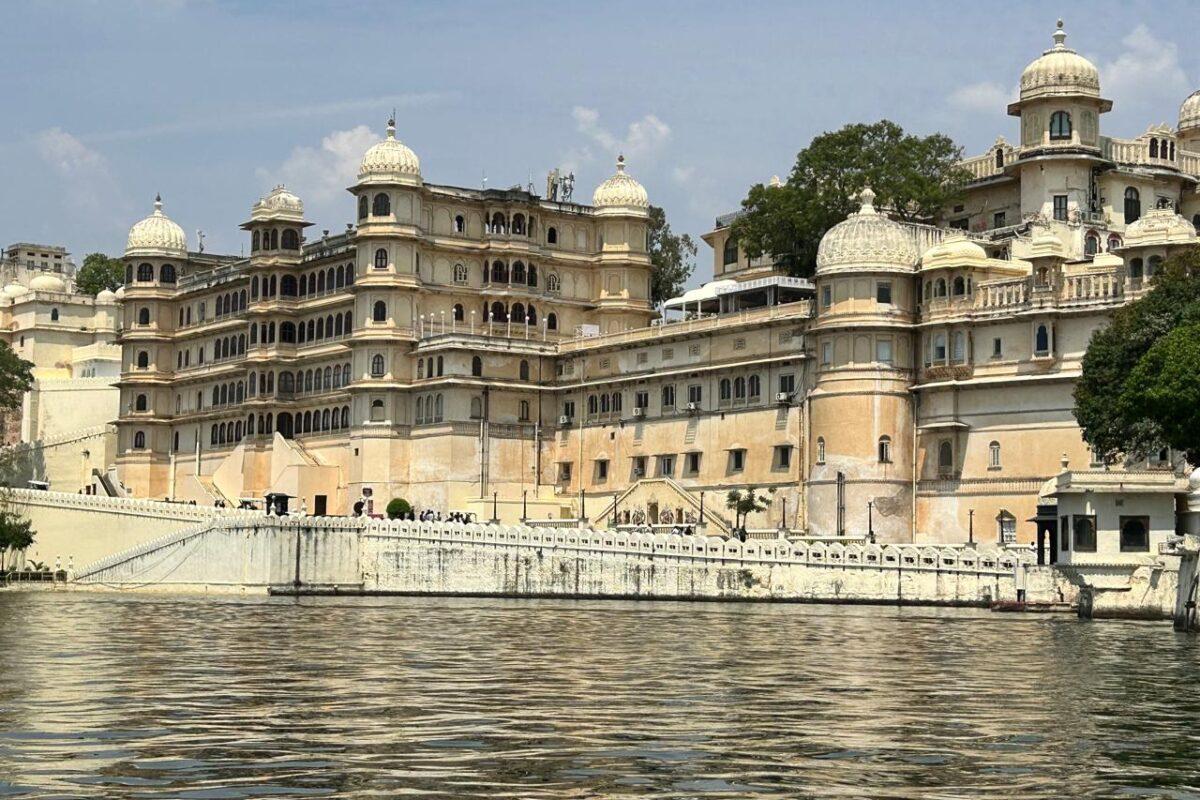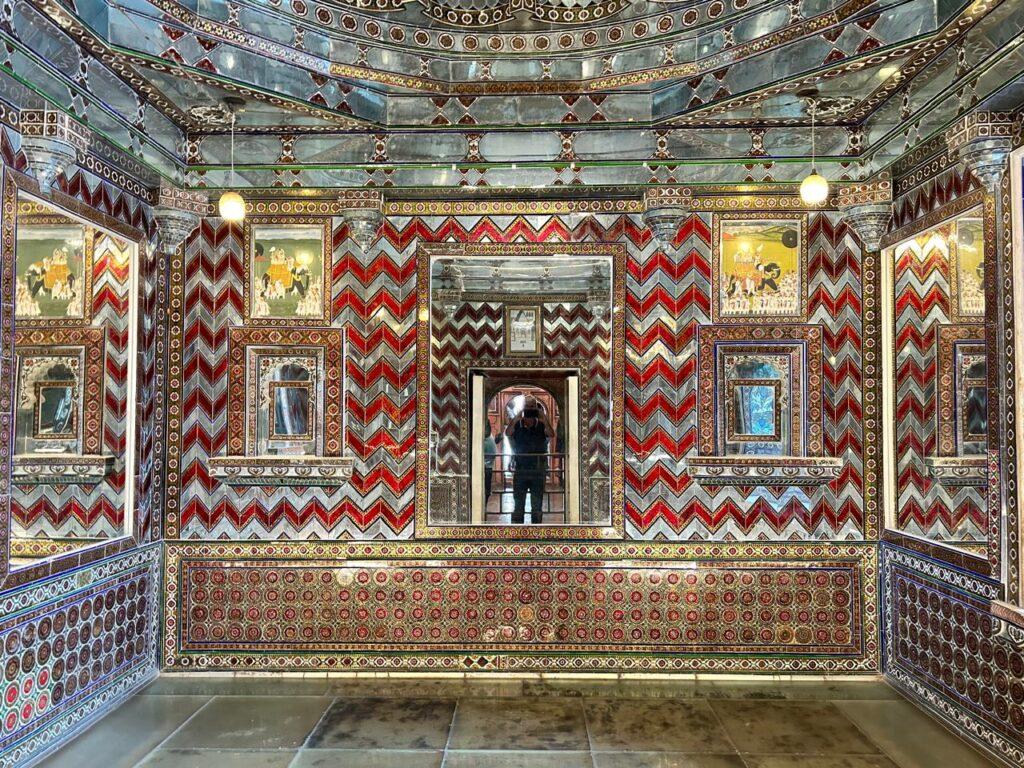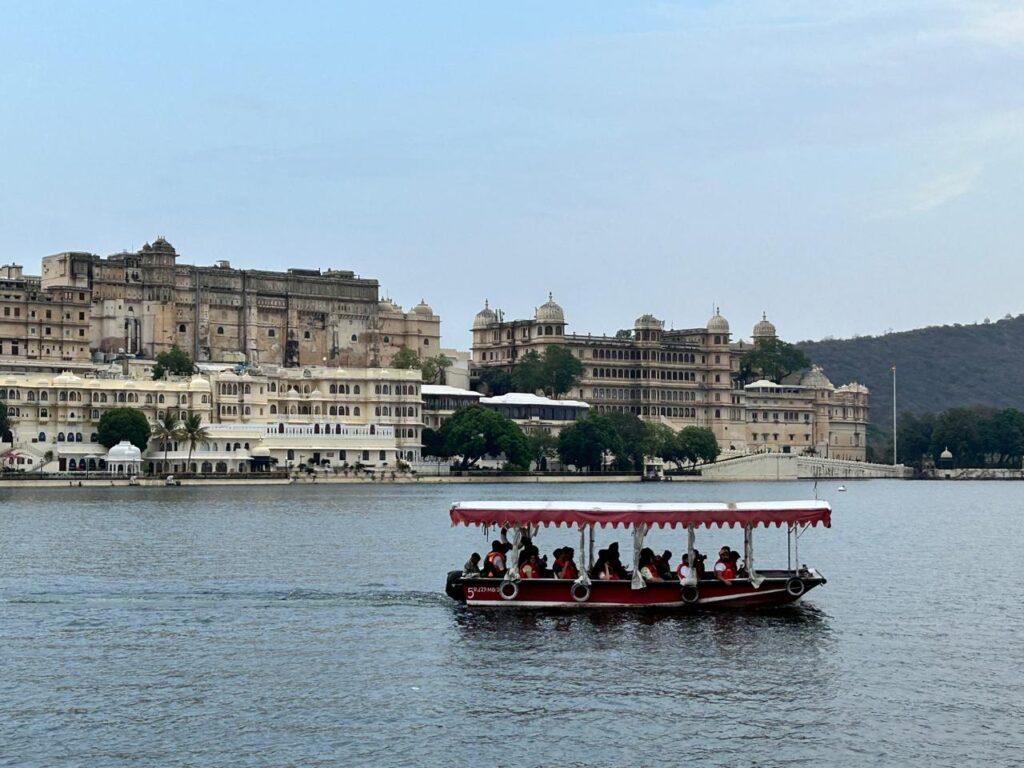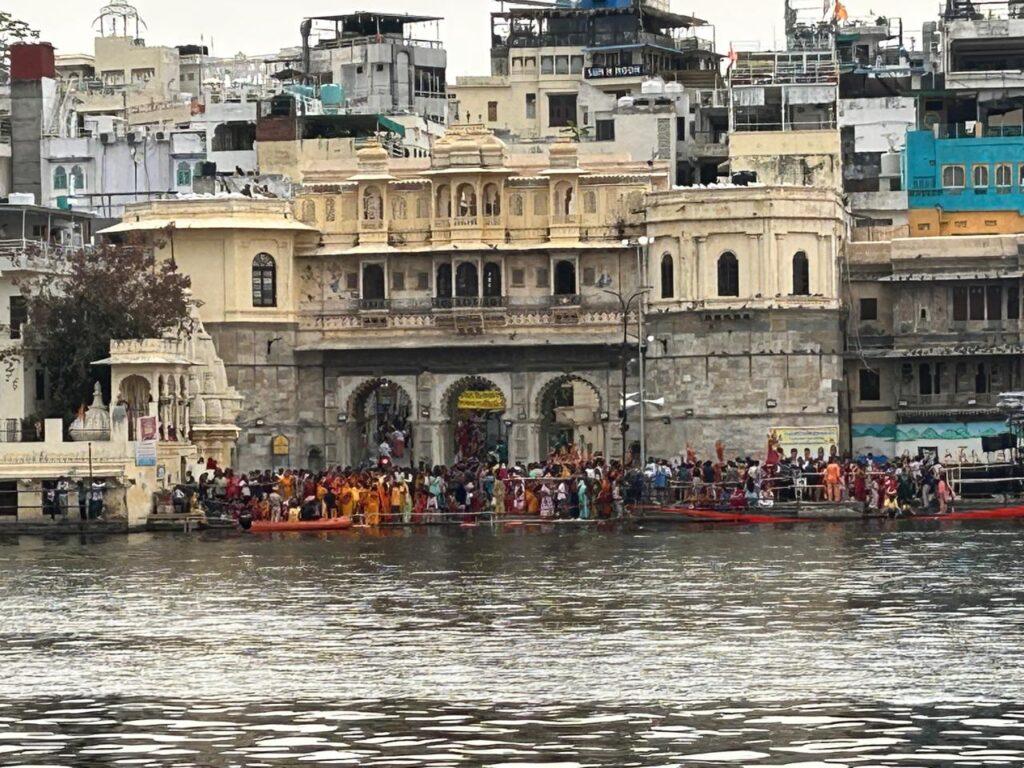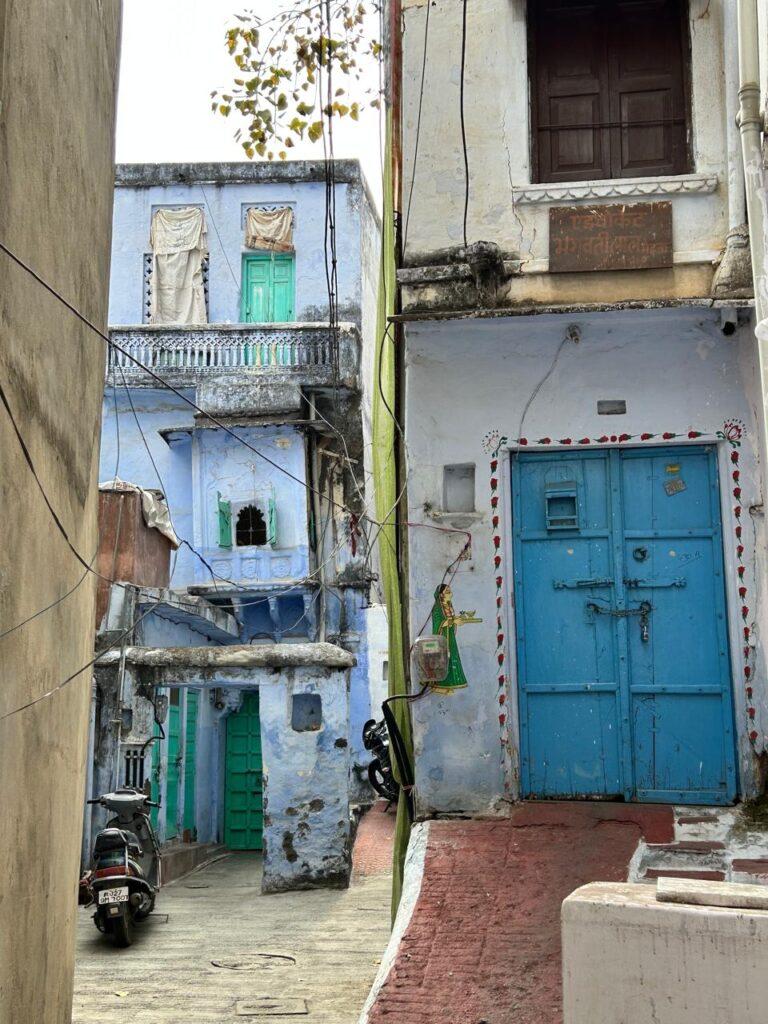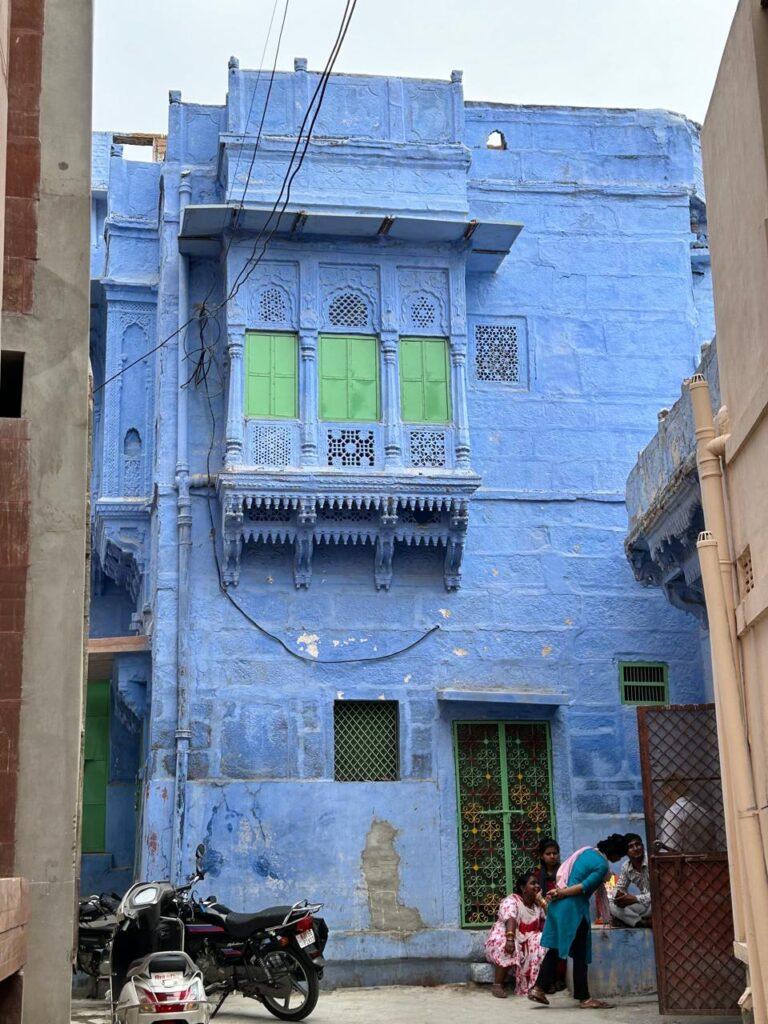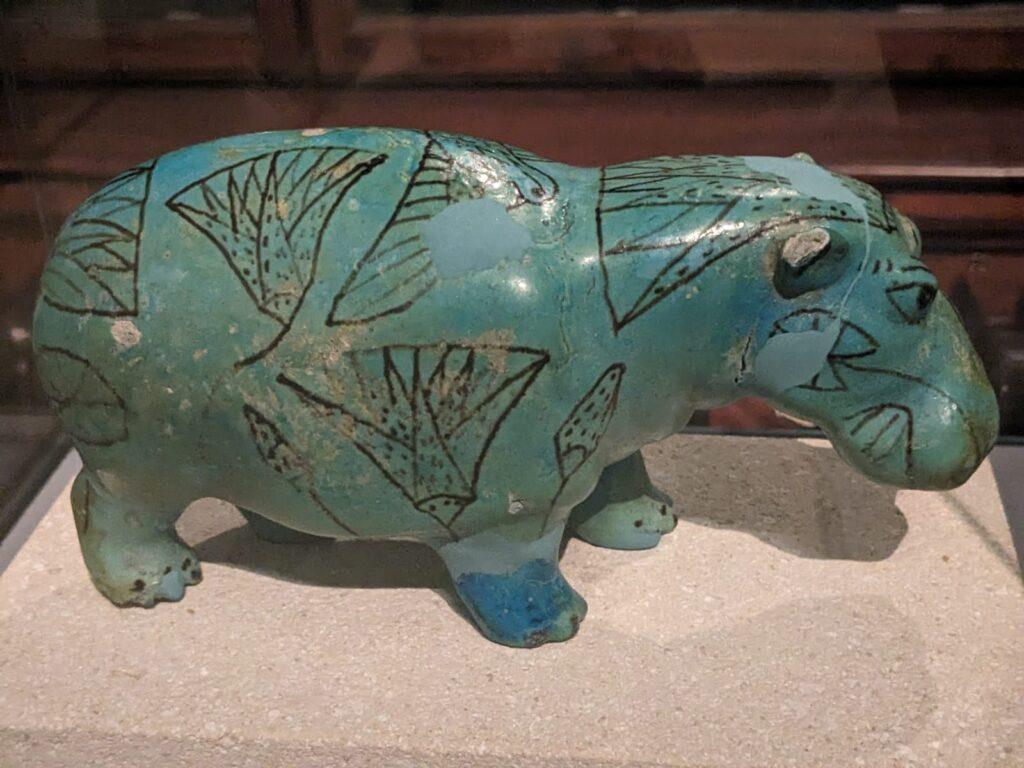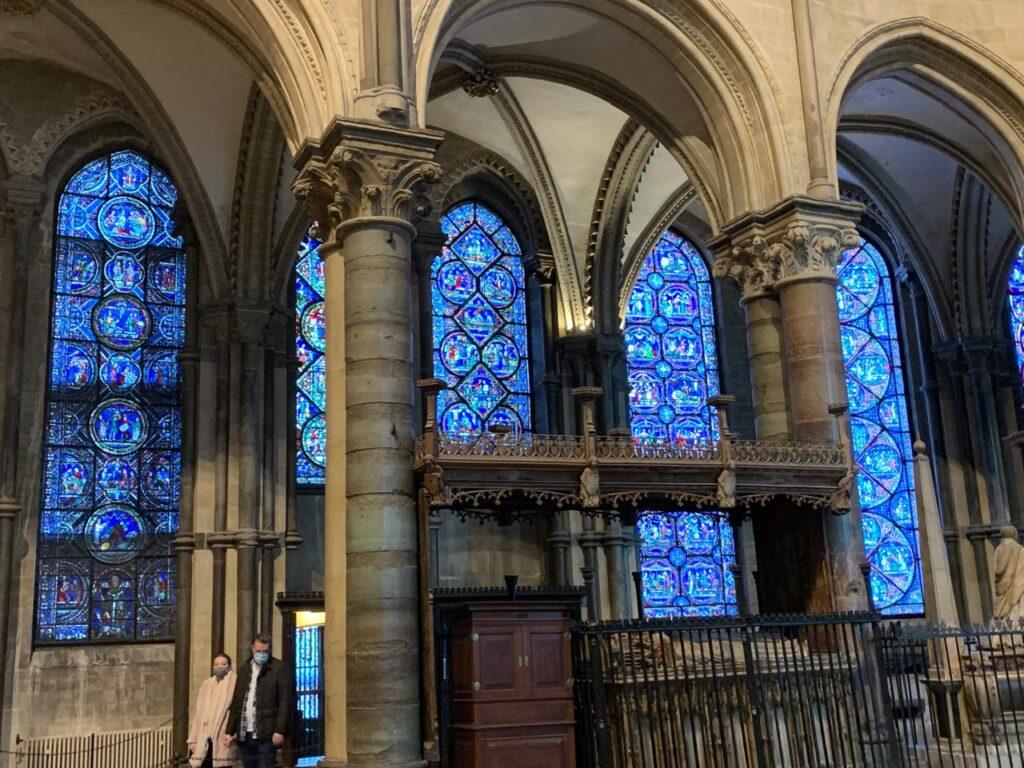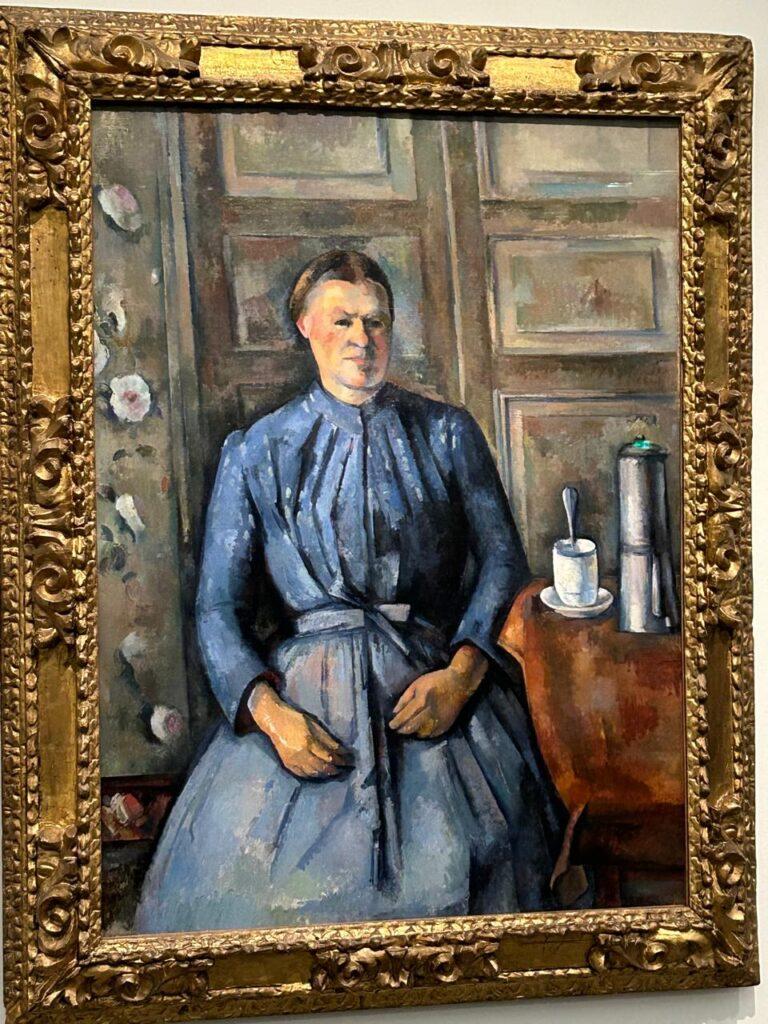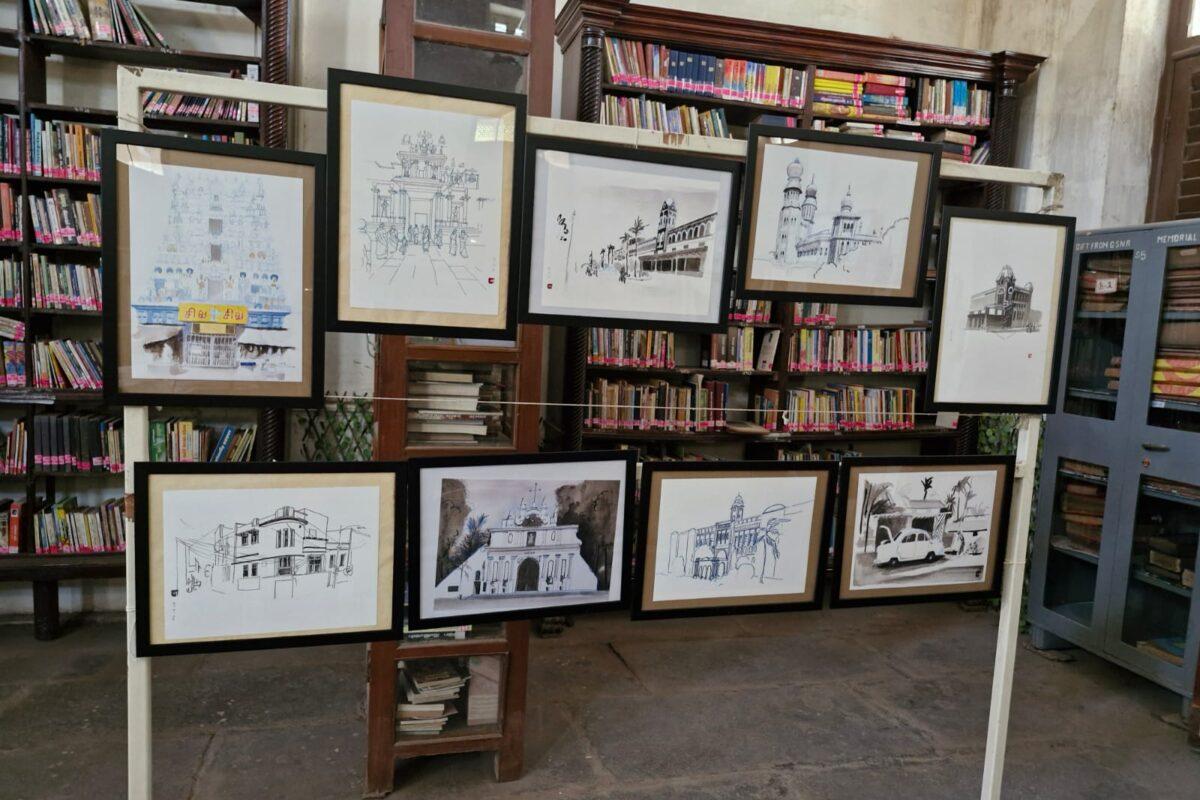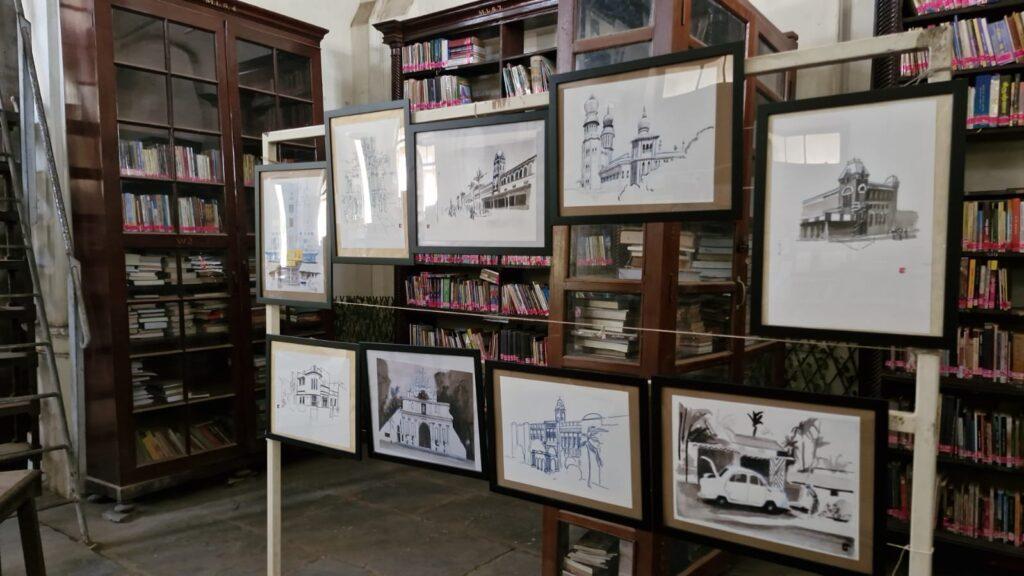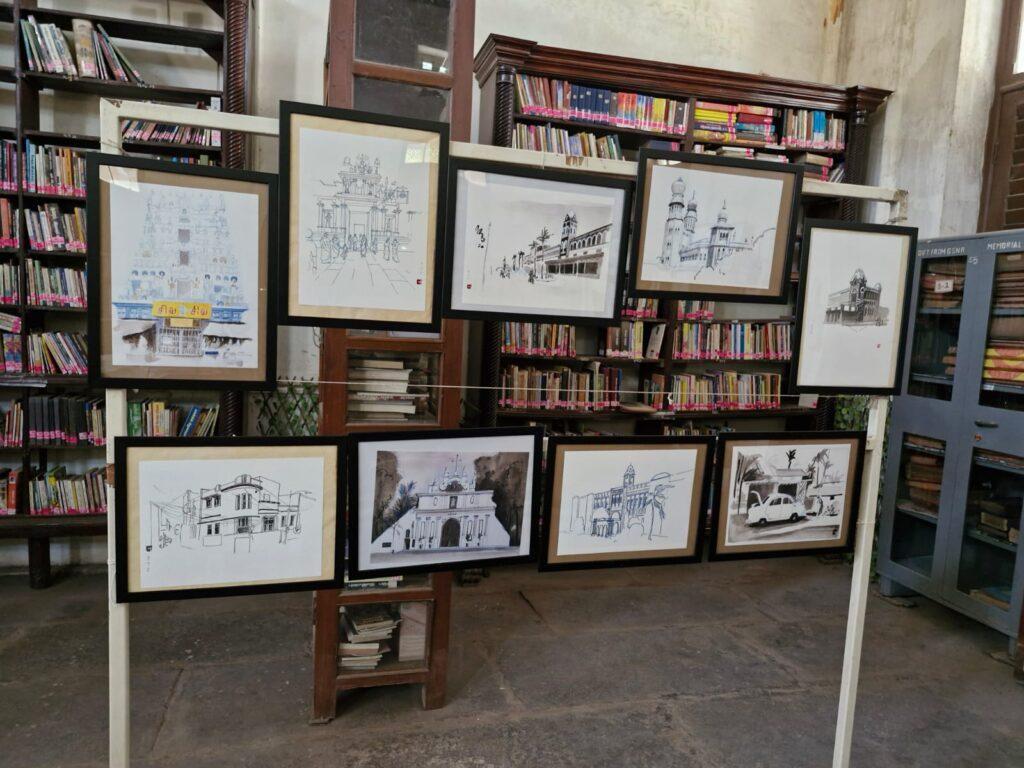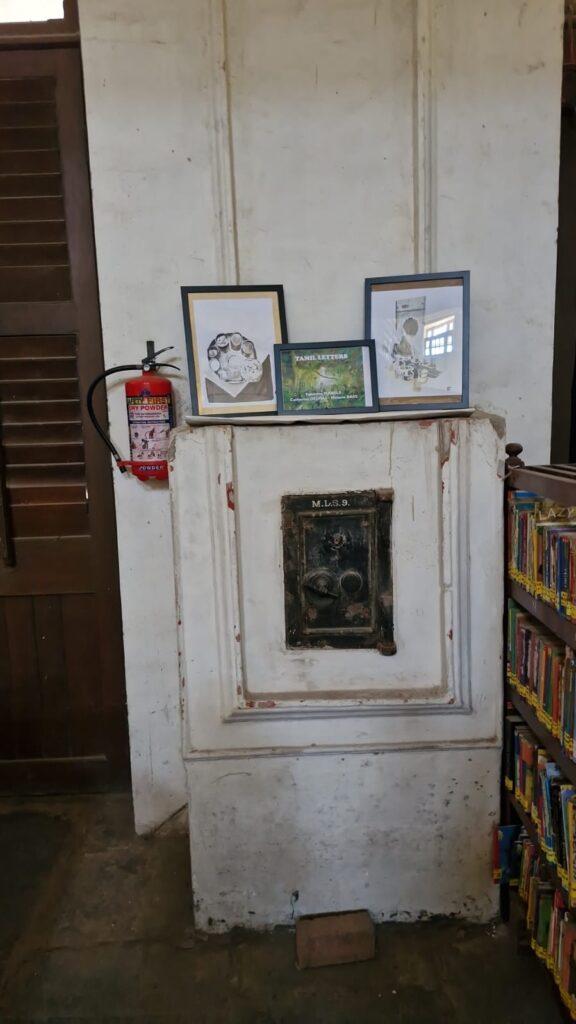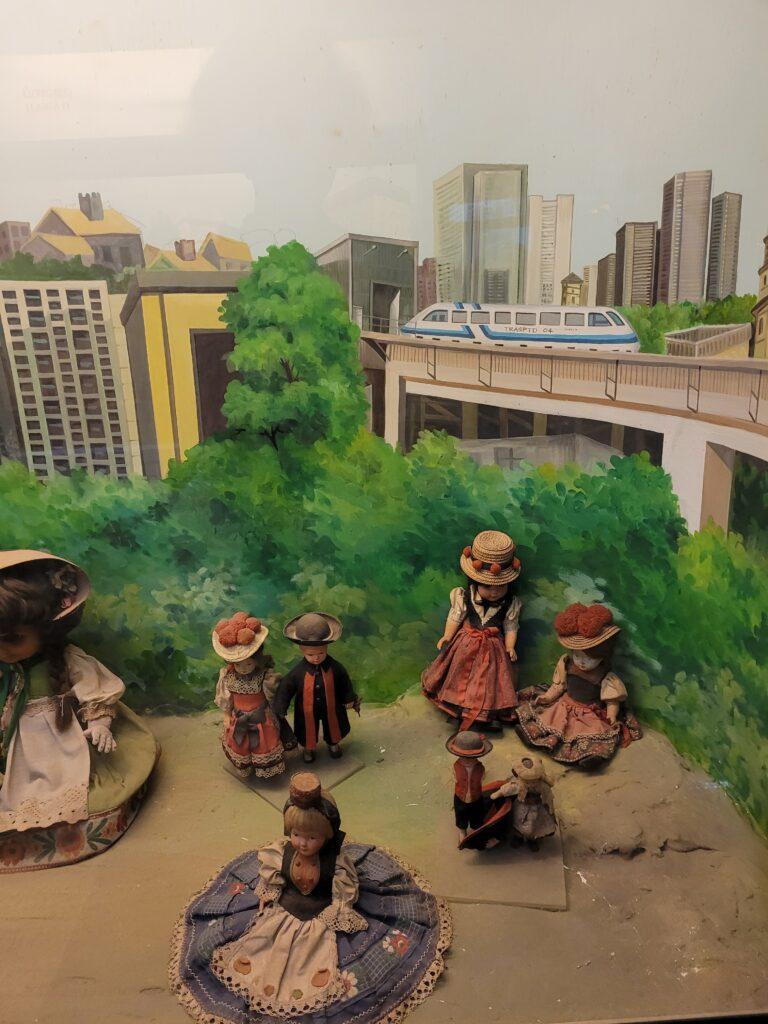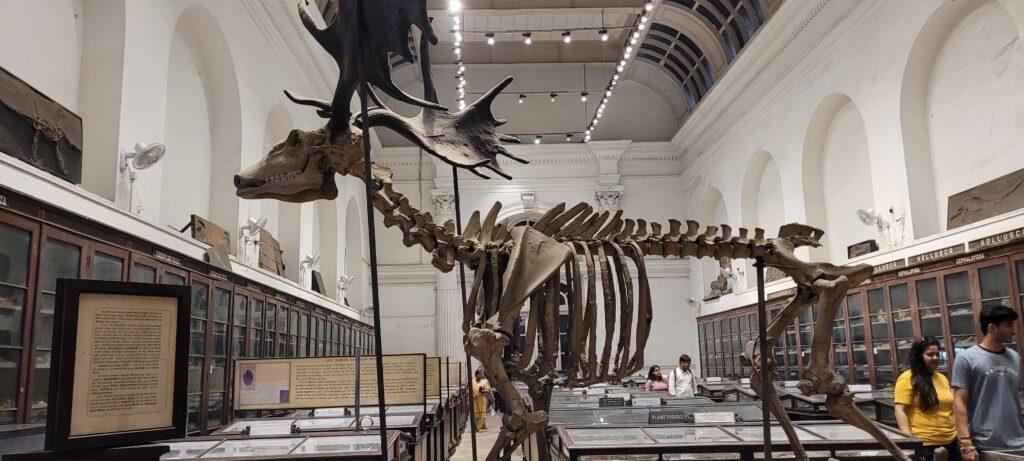Chandigarh est appelée The City Beautiful, la ville belle. Pourtant, belle elle ne l’est pas forcément. En revanche elle est unique. Unique pour, son histoire, sa planification, sa richesse, son ordre et sa propreté. Elle est surtout totalement différente du reste de l’Inde. En outre, Chandigarh est une capitale particulière. Car elle se trouve à la tête de 2 Etats, le Punjab et l’Haryana et de son propre territoire.

Pourquoi aller à Chandigarh ?
Depuis Chennai, la compagnie Indigo dessert en 3 heures les deux villes. C’est donc un voyage simple pour un dépaysement garanti. Plus encore que passer du Sud au Nord en une demi-journée, on quitte le chaos de Chennai pour l’ordre et la régulation. On délaisse l’amalgame tentaculaire de villages, bruyant, chaud pour une cité organisée, planifiée sans histoire et sans grand charme. On aborde surtout la vision d’une Inde différente.

Pourtant, l’aéroport à unevingtaine de km de la ville, en territoire Punjabi, ne laisse rien imaginer de la ville géométrique. La seule concession historico-religieuse de cette dernière transparait d’ailleurs dans le nom, issu du temple local de Chandi. Une fois dépassés les bidonvilles et champs de blé annonciateurs d’une culture et d’une gastronomie différente, on croise les panneaux appelant au silence. Les directions indiquent des secteurs numérotés et non des villages. Les ronds-points fluidifient la circulation. D’emblée on change de pays.

Pourquoi Chandigarh ?
Pour comprendre ce paradoxe d’une capitale double, gouvernant un territoire, il convient de revenir à la fondation de la ville. Car contrairement à la majorité des cités indiennes, souvent plurimillénaires ou au pire de fondation coloniale, Chandigarh est une ville récente.
Sa fondation remonte à l’indépendance de l’Inde suivie de la Partition. Lorsqu’en 1947 le Pakistan fut détaché du grand empire anglais, le Punjab se trouva partagé. D’un coté de la frontière, un Punjab peuplé majoritairement de musulmans conservait la capitale historique Lahore. De l’autre côté, le nouveau Punjab indien. Ce dernier regroupe une mosaïque ethnique et culturelle. Les habitants ne se retrouvaitent donc pas dans la ville sikhe de Amritsar. Pendant 6 ans, la ville montagneuse de Shimla occupa les fonctions de capitale du Punjab. Pour éviter davantage de remous et suivant les idées modernistes de Nehru concernant l’Inde Nouvelle, on décida la création d’une nouvelle ville. L’idée de Chandigarh devint alors réalité.
Chandigarh, vision d‘architectes
Construite sur les piémonts du massif des Shivaliks, Chandigarh représente la meilleure expérience urbaine du XXe en Inde. Si d’autres cités sont nées quasi-ex nihilo de la volonté de Nehru et des pères de l’Inde contemporaine peu ont atteint un tel degré d’accomplissement.

Dans les faits, une équipe américaine commença le travail. Albert Mayer et Matthew Novicki, dessinèrent une ville en éventail en réfléchissant à la problématique des cités jardins. Très à la mode au Royaume-Uni, ce modèle excluait les gratte-ciels peu conformes aux habitudes indiennes.
Ce projet, abandonné à la mort accidentelle de Nowicki en 1950, passa alors à une équipe plus européenne. En pleine guerre froide et non alignement, une équipe d’Europe de l’Ouest représentait un choix plus stratégique.

Corbusier, architecte franco- suisse renommé mais à la recherche d’un nouveau souffle et d’une œuvre majeure réalisa alors son idée d’une cité idéale. Des secteurs de 800 x 1200m divisent donc « sa » ville.
Plus exactement il redessina le Master Plan, plus organique, de l’équipe américaine. Il y surimposa une grille en damier parcourue de longues avenues hiérarchisées. Son cousin Pierre Jeanneret se chargea de l’appliquer sur le terrain pendant 15 ans. Durant 3 ans, le couple britannique Jane Drew et Maxwell Fry lui vint en aide. Ces trois architectes sont ceux qui ont réellement construit la ville. Ce, même si le crédit en revient aujourd’hui uniquement au consultant. Celui-ci se contentait de venir visiter le gigantesque chantier deux fois par an.
La ville de Corbusier ?
La nouvelle ville se pare de 3 des 6 édifices monumentaux voulus par l’architecte visionnaire. On y voit aussi une multitude d’unités d’habitations régulières et répétées à l’infini. Pierre Jeanneret n’eut pas d’autre choix que la monotonie, en raison de contraintes budgétaires quasi insolubles.

Le chantier connut un double coup d’arrêt en 1965 avec le décès de Corbusier puis en 1967 à celui de Pierre Jeanneret. En 1966, un nouvel Etat, l’Haryana se détacha du Punjab indien. La ville se trouvant sur la frontière devint de fait double capitale des deux états et territoire autonome.
La cité idéale de l’architecture moderniste
Le plan de Corbusier reprenait en partie son modulor (métaphore de l’être humain). Il interprétait la ville comme un homme idéal. La tête correspondait aux organes du gouvernement ici appelée capitole sur le modèle de la république romaine. Le cœur commercial (secteur 17) et les bras perpendiculaires aux axes principaux accueillaient eux les centres académiques et lieux de loisir

Ce complexe est classé au patrimoine de l’Unesco et ne se visite que sous haute surveillance. Le reste de la ville s’organise en secteurs numérotés. Ceux-ci répétent toujours la même organisation. Chacun regroupe écoles, marchés et parcs. L’idée étant de garantir un équilibre de vie aux habitants en respectant les principes corbuséens de lumière, espace et verdure. Et de fait, Chandigarh apparait régulièrement en tête des villes les plus riches. Mais surtout les plus agréables à vivre d’Inde avec ses nombreux parcs, sa circulation relativement fluide et sa scène culinaire. La ville pose ainsi la question de l’influence du lieu sur le comportement humain.

Cette ville futuriste des années 1960 aménagée autour de la place prépondérante de la voiture prévoyait un système hiérarchisé de routes (les 7voies= v7) ombragées. Les voies les plus importantes correspondaient aux bretelles d’autoroute, les V2. Les nationales, les V3, comportent des trottoirs et des voies cyclables jusqu’aux V7 chemins piétonniers. Chaque secteur était censément autosuffisant. Ils offraient un cadre de vie global aux habitants de l’école au marché, ce dans une distance raisonnable.

Imaginé il y a 75 ans, ce plan peut étonner par son aspect visionnaire. Il prévoit déjà l’importance fondamentale de la voiture au moyen d’avenues énormes et de parkings nombreux. Ce que l’on appelle aujourd’hui mobilités douces est déjà intégré.
Cependant, la zone industrielle, la gare et les quartiers pauvres se situent à l’extérieur de ce Master plan. Toute pauvreté est donc exclue de la ville de Chandigarh. Ce qui donne une idée plus complète de la vision corbuséenne et de sa méconnaissance des réalités indiennes.