Interview avec Annu Jalais, anthropologue, chercheuse et Professeur associée à l’Université KREA
Propos recueillis jeudi 16 février 2023
Les Français de Chennai ont eu la chance de rencontrer Annu Jalais en novembre dernier lors d’une remarquable présentation du système social indien : les castes. Aujourd’hui, elle a gentiment accepté de me parler de ses recherches et de ce qui l’a amenée à travailler sur les populations subalternes.
Merci pour cette interview Annu Jalais. Pour commencer, peux-tu te présenter et nous parler de ton itinéraire personnel ? Qu’est ce qui t’a amené à étudier l’anthropologie ?
Une enfance indienne
Je suis née à Calcutta de parents français qui se sont rencontrés en Inde dans les années 1970 et ont décidé d’y rester. Ils étaient très engagés en tant que travailleurs sociaux dans une ONG indienne. J’ai grandi dans le milieu populaire de Salkia, à Howrah, le long du fleuve Hooghly.
A l’âge de 7 ans, j’ai passé presque une année entre la France et la Suisse. J’y ai remarqué les différences culturelles, que je vivais déjà en Inde. Par exemple, la coutume française veut que l’on remercie à vive voix à travers des mots, mais au Bengale, cela ne se fait pas. C’est parfois même mal vu. Il faut prendre les cadeaux à deux mains, s’incliner légèrement, et surtout ne pas les ouvrir. En maternelle, les filles à l’école locale ou j’étais la seule « non-Indienne », étaient curieuses de la couleur de mes cheveux, de qui j’étais…
Le passeport de mon inclusion a été la langue. Je parle et j’écris Bengali comme mes amies Bengalies. Nous vivions dans un quartier populaire, mais sommes allés dans de bonnes écoles religieuses avec anglais comme première langue, bengali en deuxième langue, et Hindi en troisième langue. A la maison nous lisions beaucoup en français. J’ai obtenu un baccalauréat indien – le Uchhya Madhyamik.
Une formation supérieure en Europe
Avec ce diplôme, je suis partie en France, admise en classe Préparatoire au Lycée Fénelon. Puis je me suis inscrite aux Langues O (aujourd’hui INALCO) sous la houlette de l’extraordinaire Professeur France Bhattacharya. En même temps, j’ai eu la chance de suivre les cours de littérature anglaise à Paris III. Passionnée de littérature et prête à étudier celles de mes 3 langues préférées, je me suis lancée dans un DREA. Ce diplôme de recherche et d’études appliquées de 4ème année portait sur le concept du Viraha (douleur causée par la séparation amoureuse). Je devais traduire des chants collectés au nord du Bengale occidental, en Assam et au Bangladesh et en expliquer les formes linguistiques. Mme Bhattacharya a vite remarqué que mon intérêt se portait en fait plus sur le contexte et sur la vie des femmes qui chantaient ces chansons que sur la forme littéraire de celles-ci.
Spécialisation et Recherche
A l’époque, je dévorais Amitav Ghosh « In an Antique Land », l’histoire d’un anthropologue parti dans un village égyptien. Du coup, je me suis inscrite en licence d’anthropologie à Nanterre. Là, j’ai eu la chance de rencontrer le Professeur Steven Uran qui travaillait sur l’identité ethnique. Il m’a recommandé de continuer au Royaume-Uni si je voulais entreprendre des études sur l’Asie du Sud. Je suis alors rentrée en Masters en Anthropologie Sociale à la London School of Economics (LSE). Les professeurs en étaient Jonathan Parry, spécialiste de la « bonne mort » dans l’Hindouisme et des brûleurs de morts à Bénarès, et Chris Fuller, spécialiste des brahmines du temple de Meenakshi dans le Tamil Nadu. Ensuite, j’ai enclenché avec un MPhil et un PhD sur les Sundarbans, dans la baie du Bengale. C’est la plus grande mangrove au monde et où il y a des tigres mangeurs d’hommes.
Sur le terrain
Cette expérience s’est révélée particulièrement difficile et passionnante. Je connaissais la région pour y être allée enfant avec mes parents. Mon père y avait construit, avec son ami architecte Shobhanlal Bonnerjee, le premier abri anticyclonique. C’était après le désastreux cyclone de 1988 qui a fait plus de 6000 morts. J’y étais retournée avec mon école et avais été fascinée par les croyances et le syncrétisme de la région. En fait, je voulais comprendre leur refus de contrer les attaques des tigres en portant des masques préconisés par les scientifiques et distribués gratuitement par le gouvernement. Il me fallait retourner, enquêter, comprendre.


Comment en es-tu venue à t’intéresser aux questions concernant les Dalits ?
Une exposition précoce
Mon père qui était venu en Inde avec l’association Frères des Hommes a travaillé avec un des grands disciples de Gandhi, Vinoba Bhave, dans le Bihar. Il avait été touché par cet homme qui luttait, d’une manière pacifique, pour une Inde avec plus de justice sociale. La façon dont les Dalits étaient traités l’avait marqué. Il était un des seuls à me parler d’Ambedkar et à m’expliquer pourquoi le système de « réservation » était si important . En effet, c’était une reconnaissance du fait qu’il y avait discrimination, et ceux des plus basses castes avait besoin de ce système pour s’en sortir. Les préjudices contre les Dalits étaient, et sont toujours, importants.
Avec ma mère, qui était venu étudier le Bharatnatyam (une danse classique indienne), ils ont tenu à nous élever comme « à la locale » et à apprécier la culture Bengalie. Nous prenions des cours de chant de Tagore et de Nazrul et de danses indiennes auprès d’Amala Shankar. Depuis très jeune, je vivais dans ces différences culturelles. J’étais consciente des différences de castes, de classes, et de cultures, du fait des amis variés de mes parents.
Dans les Sundarbans
Mon enfance a Salkia, et nos virées dans les campagnes Bengalies pendant les vacances, m’avaient donc préparée à vivre dans un village sans électricité ni eau courante, des toilettes faites de sacs de jutes pendues autour d’un trou. J’étais de ce fait heureuse d’avoir choisi l’anthropologie. Cela me permettait de réfléchir aux grandes questions sur la culture tout en vivant, pendant deux ans, dans un village des Sundarbans. A Londres, un ami Dalit Tamoul, Murali Shanmugavelan, m’a introduite à la littérature Dalit à travers le site Velivada et l’autobiographie de Bama. Le mot Tamoul « paraiyan » littéralement « intouchable » , a d’ailleurs donné le mot français paria. C’est la caste des joueurs de tambour. Ils touchent la membrane du tambour – faute de peau de vache. De ce fait, ils sont « intouchables ». La plupart des mots dans les langues Indiennes pour les castes considérées comme « intouchables » veulent littéralement dire « intouchable » ou « sale ».
Le drame de la partition du Bengale
La question des « basses » castes est apparue avec acuité au Bengale après le massacre de 1979 dans une des îles des Sundarbans, du nom de Marichjhapi. De nombreux réfugiés sont venus dans les années 1950 et 1960, suite à la partition de l’Inde quand le Bengale a été divisé. Ceux arrivés juste avant la création du Bangladesh en 1971, avaient été envoyés dans des camps de réfugiés. Ces camps aux terres arides se trouvent au centre de l’Inde. Ils avaient décidé de revenir au Bengale et de s’installer sur l’ile de Marichjhapi dans les Sundarbans. Les réfugiés qui avaient réussi à s’installer sur l’île en furent brutalement chassés par le nouveau gouvernement du Bengale. Certains en étaient morts. Ils s’étaient sentis trahis. Pour les réfugiés, ainsi que pour les villageois des Sundarbans, ce terrible évènement avait été possible seulement parce qu’ils étaient de basses castes.
Quels sont tes sujets de prédilection ?
Lorsque j’étais à la LSE, le grand anthropologue et philosophe français, Professeur Philippe Descola, avait été invité dans notre département. Il nous avait parlé de la relation des Jivaros avec le jaguar. Cela a résonné en moi lorsque j’ai découvert les relations que les villageois portaient aux tigres. J’ai décidé de me spécialiser sur l’anthropologie de l’environnement, étudier comment les gens comprennent l’environnement et leur rapport aux « non-humains ». On sort ici de la distinction nature / culture à la Descartes pour lui préférer un tout écologique dans lequel s’inscrit l’homme. Pour cela, il convient de changer de point de vue. Il convient d’adopter celui des gens qui vivent dans ce système où les animaux et les plantes ont autant de valeur que les humains. C’est d’ailleurs pour cette raison que je préfère le terme « non-humain » au terme « animal ».
Environnement et religions
Outre les castes, et les conceptualisations du non-humain et de l’environnement dans différentes cultures, un autre sujet qui me passionne est la religion, et comment les croyances s’enchevêtrent.
Pour mon deuxième livre, co-écrit avec Joya Chatterjee et Claire Alexander (pour l’étude duquel nous avons bénéficié d’un financement de la part de la AHRC), je suis partie effectuer des recherches anthropologiques sur la migration au Bangladesh pendant deux ans. En effet, 95% de l’émigration dans le monde se situe dans le Global South. D’ailleurs, le pays qui a accueilli le plus de migrants ces derniers temps est le Bangladesh. Plus de 1 Millions de réfugiés Rohingya y sont arrivés en effet. On ne le sait pas, on ne le dit pas assez, mais le gros de l’émigration se fait dans les pays pauvres.
Cohaitation et tolérance
Ce qui m’intéresse dans mon travail sur le sous-continent Indien c’est que depuis toujours, il y a cohabitation entre des peuples, des religions, des cultures différentes. Jusqu’à récemment c’était une mosaïque qui réussissait à cohabiter sans qu’il y ait de continuelles guerres de religions. L’idée dans laquelle j’ai grandi était celle d’une grande tolérance. Nous suivions le dicton de Sri Ramakrishna Paramahansa « Il y a autant de voies qu’il y a de croyances ». Après avoir vécu dans une société à dominance Hindoue, je voulais vivre dans une société à dominance Musulmane. Et j’ai beaucoup appris pendant mes deux années au Bangladesh.
Avec la partition de l’Inde, la tolérance face aux différences, semble avoir été remplacée par la conviction de la supériorité de la religion et pas tant de la culture et de la langue qui nous unis. Malheureusement le nationalisme dans les pays de l’Asie du Sud est de plus en plus lié à une identité religieuse politique très étroite et non à une identité linguistique, culturelle, ou a un passé vécu d’une pluralité religieuse.
Peux-tu nous parler de ton cursus d’enseignante universitaire et de tes projets actuels ?
J’ai enseigné à la LSE pendant ma thèse et à l’université de Goldsmiths à Londres. Après mes deux années au Bangladesh, j’ai passé une année passionnante à l’Université de Yale, en post-doc au Agrarian Studies Program. Puis, j’étais à Amsterdam (à la IISH) et à Leiden (à la IIAS) quelque temps avant d’aller à la JNU à Delhi et au centre CRASSH à Cambridge en tant que post-doc. Puis j’ai travaillé pendant presque 10 ans à la National University of Singapore (NUS) en tant qu’enseignante -c’est ce qui m’a ouvert à l’Asie du Sud Est. L’Asie contiendras bientôt les 2/3 de la population mondiale et c’est ici que se joueront tous les grands enjeux de demain.
Travaux récents
Pendant la pandémie, Aarthi Sridhar de la Dakshin Foundation à Bangalore, et moi-même avons réalisées le projet « The Southern Collective » réunissant des chercheurs issus de diverses disciplines travaillant dans la région de l’océan Indien. Notre équipe, avec Rapti Siriwardane et Alin Kadfak, s’est formée au plus fort de la pandémie pour répondre à l’appel de la SSRC à construire une collaboration transrégionale pour l’océan Indien. Nous partageons des intérêts communs liés aux défis côtiers et marins et une volonté de promouvoir des collaborations Sud-Sud avec la société civile pour produire et démocratiser la production de connaissances sur les répercussions du changement climatique sur l’environnement marin de l’océan Indien. Nous avons aussi recueilli des interviews sur les effets de la pandémie de Covid-19 sur les migrants des communautés côtières.

Enfin, nous avons bénéficié d’un financement de la part de l’Université de Paris et de la NUS pour travailler avec Mathieu Quet, Marine Al Dahdah, Vinod Saranathan, et l’artiste Maïda Chavak sur un projet sur les animaux en Asie. Ce fut passionnant puisque, cela a non seulement permis de mettre mes étudiants à contribution, mais aussi de collaborer avec une vingtaine d’artistes de différentes régions d’Asie. En ce moment, je travaille sur un livre qui étudie la place des « non-humains » dans les sociétés Indiennes et Chinoises.

Et aujourd’hui
Depuis un an, j’ai quitté Singapour pour me rapprocher de la famille. J’enseigne aujourd’hui à KREA, une nouvelle université « liberal arts » à 2h au nord de Chennai. Je donne des cours sur la religion, l’environnement, l’Anthropocène, et l’introduction à l’Anthropologie.
Avant de nous quitter, avec tous mes remerciements, peux-tu nous conseiller des livres, à commencer par les tiens ?
Jalais, Annu. 2010. « Forest of Tigers : People, Politics and Environment in the Sundarbans » London, New Delhi : Routledge.
Jalais, Annu. 2016. Avec Claire Alexander et Joya Chatterjee. « The Bengal Diaspora : Rethinking Muslim Migration », London, New York : Routledge.
Dumont, Louis. 1966. Homo Hierarchicus: Essai sur le système des castes (1966)
Jaffrelot, Christophe. 1998. La Démocratie en Inde. Religion, caste et politique, Fayard, Paris.
Jaffrelot, Christophe. 2000. Dr Ambedkar – Leader intouchable et père de la Constitution indienne (in French), Sciences Po.
Mohammad-Arif, Aminah et Christophe Jaffrelot. 2012. Politique et religions en Asie du Sud: le sécularisme dans tous ses états? Collection Purushartha, Paris, Editions de l’EHESS, 2012.
Naudet, Jules et Christophe Jaffrelot. 2013. Justifier l’ordre social: caste, race, classe et genre, edité par Jules Naudet et Christophe Jaffrelot, Paris: PUF/La Vie des Idées, 2013.
Naudet, Jules. 2012 | Entrer dans l’élite. Parcours de réussite en France, aux Etats-Unis et en Inde, Presses Universitaires de France, “Le lien social” series.


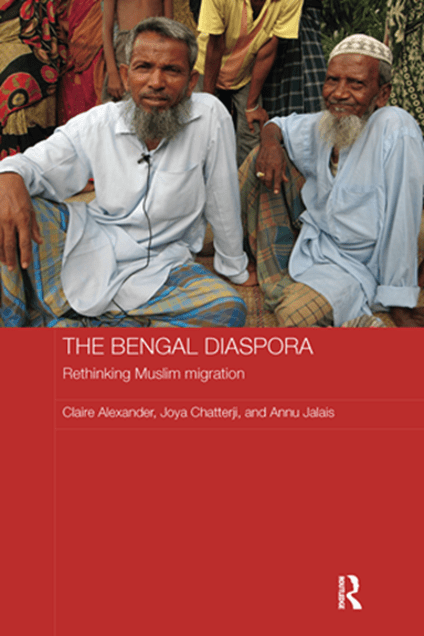
Coucou, Annu, je suis tombée par hasard, sur toi!! Quelle joie d’avoir des nouvelles grâce à cet article!!